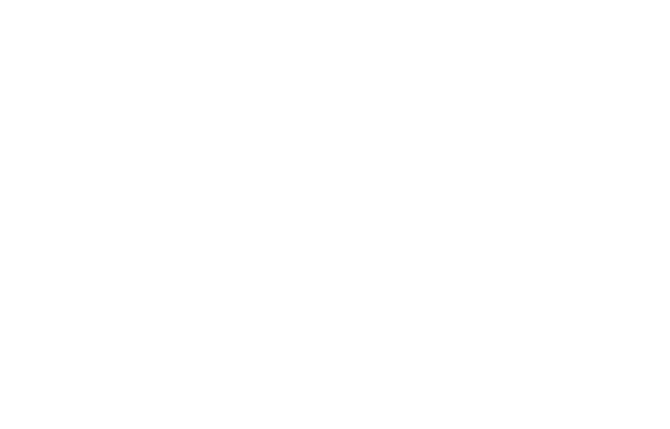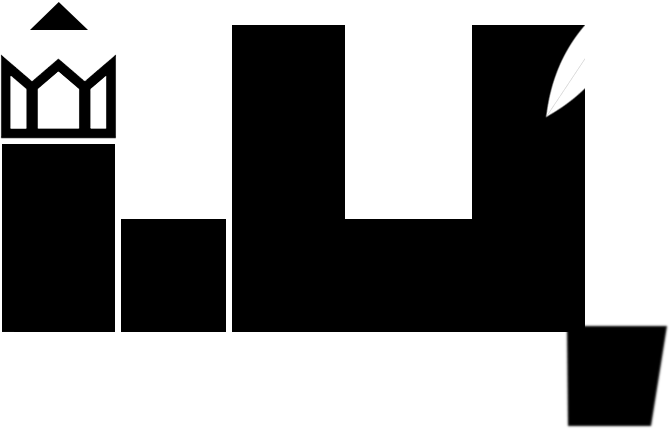par Serghei Grachev
Voir en rêve un paysan est un signe qu’un travail pénible vous attend bientôt, un travail qui exigera de vous beaucoup de patience.
(Extrait du dictionnaire des rêves Felomena)
Par un jour d’été, alors que les habitants d’Émilie-Romagne se préparaient déjà à la cueillette des pêches, le paysan Enzo Fiore entendit le roucoulement de la tourterelle – tor-tor. Cet oiseau, avec son dessin écailleux sur le cou, était perché au sommet du magnolia qui poussait en face de sa maison et chantait sans relâche, ou plutôt roucoulait – bas et sourd. Le paysan pensa: «Un visiteur arrive.» Bien des années plus tôt, quand Enzo avait environ cinq ans, sa mère lui disait que la tourterelle venait du sud, de Calabre, et qu’elle apportait la chaleur sur ses ailes. Mais son expérience personnelle suggérait au paysan un autre présage: cette tourterelle amenait des visiteurs dans la propriété.
Or, à ce moment-là, la ferme n’avait pas besoin d’un visiteur, mais d’un ouvrier. Enzo y pensait presque depuis la construction de la nouvelle maison à deux étages. Son père, Boscòlo Fiore, était resté vivre dans l’ancienne maison, avait vieilli rapidement et n’était plus d’une grande utilité dans le verger de pêchers ni dans la vigne. Enzo ne cherchait pas un associé, mais un jeune journalier robuste, de préférence étranger, à qui l’on pourrait payer bien moins que huit euros de l’heure. Et quand les pêches commencèrent à mûrir, Enzo comprit qu’il ne pouvait plus attendre.
***
Denis Tourov rêvait depuis longtemps de s’installer en Europe occidentale. On pouvait bien sûr partir avec un visa touristique et se fondre dans la masse des travailleurs étrangers. Mais, décidé à s’établir définitivement à l’étranger, il écarta immédiatement l’option de la vie clandestine. En rédigeant son CV à envoyer par e-mail, Denis savait qu’il n’avait pas grand-chose à mettre en avant : service militaire, trois années d’études par correspondance dans un institut technique et, en parallèle, travail dans les réseaux électriques.
Le CV en anglais et en italien avait été rédigé par un ancien camarade de classe polyglotte, étudiant à l’université de Moscou. Naturellement, Denis avait un peu enjolivé ses compétences professionnelles d’électricien haute tension, mais c’est précisément cette prétendue haute qualification qui intéressa le recruteur d’une entreprise de meubles du nord de l’Italie. On peut dire que c’est par un heureux concours de circonstances que Tourov se retrouva dans cette usine italienne où on lui signa un contrat d’un an.
Le certificat russe d’habilitation aux travaux sur installations haute tension n’avait pas été reconnu par les Italiens, et Denis travaillait donc comme monteur de meubles et, quand le patron en avait besoin, faisait aussi office d’électricien.
Au bout d’un an, le contrat ne fut pas renouvelé et Denis se sentit trompé par un employeur rusé et presque offensé par le destin. Il avait travaillé consciencieusement, n’avait jamais fait le mort, et à vingt-quatre ans ce n’était pas un âge pour être licencié. Mais une fille de Riazan, manager dans l’usine, lui expliqua que le chômage augmentait et que les étrangers étaient les premiers à sauter.
C’est depuis son ordinateur au bureau qu’elle montra à Tourov l’annonce du paysan Enzo Fiore. Dans les exploitations agricoles surgissaient constamment des problèmes avec les installations électriques et l’équipement ; Enzo cherchait un ouvrier ayant de l’expérience en électricité.
Tourov arriva à Faenza en juillet. Quand il vit Enzo pour la première fois – bronzé, bien proportionné –, il pensa : «On dirait un ancien sportif.» Comme beaucoup en cette période chaude, Enzo portait un tee-shirt blanc et un short beige court. Aux pieds, des sandales ouvertes. Mâchoire non rasée depuis longtemps, barbe noire prête à devenir fournie. Front dégarni, cheveux gris aux tempes : le paysan avait au moins quarante ans, mais il était visiblement en excellente forme physique et ressemblait à un entraîneur de football. Dans toute sa silhouette se lisaient assurance et une calme philosophie.
Ils partirent en jeep depuis la ville et filèrent entre vignobles et champs de maïs. Sur la route vers sa propriété, Enzo Fiore prononça une seule phrase :
– Le mois dernier, il n’a plu qu’une fois.
La nouvelle maison blanche à deux étages de la famille Fiore se dressait au milieu de la plaine du Pô, presque en steppe, sous un ciel sans nuages et un soleil brûlant. La mer était à une demi-heure, mais Enzo, comme on le découvrit, n’avait jamais le temps d’y aller.
Denis classa mentalement cette maison comme un cottage : elle n’atteignait pas les dimensions d’une villa de nouveaux riches russes. Pas de hauts grillages avec portails automatiques. Mais la façade était très gracieuse. L’entrée était constituée de colonnes carrées en briques, surmontées d’un toit de tuiles qui ressemblait à un bonnet exotique. Cette sorte de véranda à colonnes ouverte courait presque sur toute la façade, créant une ombre salvatrice. Au deuxième étage, une loggia non vitrée offrait une vue sur les champs et les basses montagnes qui tremblaient au loin dans la chaleur.
Le patron emmena immédiatement Tourov visiter la propriété et les terres agricoles. En un an d’usine, Denis avait appris un peu d’italien et comprenait presque tout ce que disait le paysan.
D’abord Enzo lui montra la cour de travail, les hangars, les machines agricoles, les arbres fruitiers isolés. Sur le grenadier pendaient déjà de gros fruits. Quand Enzo appela l’arbre à kakis «kaki de Romagne» et en latin Diospyros kaki («fruit des dieux»), Denis pensa : «J’ai trouvé un homme cultivé.»
– Les kakis, on les mange en novembre, expliqua Enzo. Après le déjeuner et seulement bien mûrs.
Puis ils marchèrent le long de la vigne où poussaient deux variétés : la verte et la petite sombre violacée qui sentait le vin. De la vigne ils tournèrent vers le verger de pêchers, qui parut immense à Denis. Les arbres s’étendaient en rangs ordonnés vers les montagnes.
Tourov demanda :
– Il y a d’autres ouvriers ?
– Moi et ma femme, répondit Enzo avec un sourire. Le sourire semblait gentil, mais Denis comprit que le paysan économisait sur la main-d’œuvre et qu’un large front de travail attendait donc l’électricien russe. Dans ces cas-là, Tourov avait l’habitude de se répéter mentalement : «L’homme ne peut faire que ce que ses forces lui permettent. Peut-être un peu plus.» Tourov ne craignait pas le travail, et de toute façon il n’avait nulle part où reculer. En Russie personne ne l’attendait : ses parents étaient morts, et dans leur appartement de deux pièces à Lotochino vivait son frère aîné avec sa femme et sa fille.
Entre les rangs de pêchers régnait une chaleur étouffante, l’air était imprégné du parfum des fruits mûrs. Les branches s’ouvraient en éventail au-dessus de la tête, soutenues par des fils de fer tendus par Enzo entre les poteaux le long des rangs. Sous les pieds gisaient beaucoup de pêches tombées, belles, juteuses, mais un vrai paysan ne mange pas celles qui sont tombées et ne les offre pas aux invités. Ce qui est tombé est perdu. Enzo choisit longuement un fruit sur une branche. Il en prit un, le regarda sous tous les angles et le jeta. Il en chercha un meilleur. Finalement il en choisit un et le tendit à Denis. La peau était lisse et Denis comprit enfin qu’il s’agissait d’une nectarine. Enzo confirma : «nettarina». Malgré l’aspect rosé, la chair jaunâtre était encore ferme, mais douce au goût.
Sur le chemin du retour, Denis vit aussi le potager où mûrissaient pastèques, courges et tomates.
– Beau verger, dit Denis, cherchant à exprimer par toute sa personne et son intonation le respect pour le laborieux patron. – Des pêches, il y en a énormément.
Enzo hocha la tête et invita l’ouvrier à déjeuner.
La table était dressée par une jeune femme vêtue d’un large pantalon blanc et d’un chemisier bleu clair ample à profond décolleté. Cou et bras étaient couverts d’un bronzage uniforme, pas trop foncé.
– Ma femme Anna, la présenta Enzo, et dans ses yeux bruns brillèrent des étincelles ardentes. C’est ainsi que parfois regardent les séducteurs sûrs qu’un nouveau spécimen rare entrera bientôt dans leur collection.
Denis décida immédiatement qu’Anna n’était pas une Italienne typique. Visage rectangulaire, front haut, menton allongé, grands yeux écartés. Joues larges, et la joue gauche lui parut plus grande que la droite. «Elle doit probablement se maquiller le menton et le front avec du blush», pensa-t-il, ajoutant mentalement que le maquillage ne l’avantageait pas beaucoup. En photo elle devait être pire qu’en vrai : c’est toujours le cas avec les traits irréguliers. Anna n’était pas une beauté, mais elle était jolie, et ses yeux ainsi que ses longs cheveux teints d’un beau châtain clair pouvaient faire forte impression sur un homme.
Sur la table, tout était produit maison : fruits, porc, poulet. Et naturellement du vin.
– Servez-vous, Giovanolo, dit Anna en indiquant avec un sourire triste le plat de porc.
«Ils l’appelaient Giovanolo, pensa le Russe en regardant les morceaux de porc. On dirait qu’ici on ne mange pas quelqu’un qu’on ne connaît pas !»
Au déjeuner, Denis découvrit qu’Anna, dans ses goûts culinaires, associait parfois des choses incompatibles : par exemple, sur des cubes de melon orange elle posait de la viande fumée. Pourtant ce curieux canapé plut beaucoup à Tourov.
Quand Anna posa les coupes de dessert, elle regarda Denis droit dans les yeux, derrière une mèche châtain ondulée, et sourit. Ce sourire audacieux, le mouvement de sa poitrine quand elle se pencha, le parfum de chocolat qui émanait de son corps – tout cela ensorcela Tourov. «Où a-t-elle trouvé un parfum pareil ?!» Ce fut comme une vague d’énergie jeune qui le submergea. Le dessert, préparé avec nectarine, noix et kiwi, acheva l’œuvre.
Captant le regard du paysan, Denis s’aperçut avec horreur qu’il y avait de la compréhension dans les yeux et aux coins de la bouche d’Enzo. Mais un instant plus tard, le visage d’Enzo, qui mangeait le dessert, redevint parfaitement serein.
Tourov continuait de sentir sur lui le regard curieux et scrutateur d’Anna. Comme si elle l’analysait dans ses capacités masculines : professionnelles et autres. Cela le mettait mal à l’aise, jusqu’à ce que le vin maison le détende.
On lui donna une chambre dans l’ancienne maison, située à une trentaine de mètres de la nouvelle. Dans sa chambre il y avait une fenêtre et derrière elle mûrissaient de gros fruits de grenadier. Cela plut beaucoup à Tourov, car l’arbre à grenades cachait en partie le mur écaillé du hangar d’en face.
Ce jour-là Tourov se sentait invité dans la propriété des Fiore. Mais dès le lendemain matin tout reprit sa place.
Ce jour-là, Tourov se sentait comme un invité dans la propriété des Fiore. Mais dès le lendemain matin, tout reprit sa place.
Enzo le réveilla à six heures. Ils burent le café ensemble et se rendirent dans le verger. Là, le paysan lui fit un briefing détaillé sur le travail à accomplir.
Tourov écouta attentivement. Des explications d’Enzo, il comprit que les pêches ne mûrissent pas toutes en même temps : il fallait donc les cueillir de manière sélective pendant presque un mois et demi. Les fruits se détachent avec soin, sans les abîmer ni les écraser. On ne prend sur les branches que ceux qui sont presque complètement mûrs, mais encore fermes. Ni les pêches dont la peau n’est pas encore rougie, ni celles trop mûres, car elles pourrissent vite et ne supportent pas le transport.
Pendant la cueillette, Enzo utilisait une plateforme motorisée. Sur cette plateforme, qui pouvait s’élever jusqu’à deux mètres et se déplacer sur roues le long des rangs d’arbres, se trouvaient des caissettes et des cagettes pour les fruits. C’est là-dessus que se tenaient les cueilleurs : Enzo, Anna et Denis. Ils détachaient les nectarines des branches et les posaient délicatement dans les caissettes, dans les compartiments individuels. Anna, elle, s’occupait surtout de coller des étiquettes sur chaque pêche. En même temps se faisait le tri : les fruits abîmés allaient dans une caisse à part.
Denis savait désormais que les fruits imprégnés de la chaleur du soleil, mûrs et parfumés, devaient être livrés au consortium agricole dans les douze heures, sinon, sans réfrigération, ils commenceraient à se détériorer. Au consortium, il y avait des chambres froides spéciales et le conseil s’occupait de tout : stockage, transport et vente de la récolte. Mais au paysan ne restaient que sept centimes le kilo pour les bons fruits, et encore, pas tout de suite, mais au fur et à mesure que la marchandise était vendue.
– Et qu’est-ce qu’on fait des pêches tombées ? demanda Denis.
– On les ramassera après, répondit Anna en le regardant les yeux mi-clos sous le foulard qui cachait ses beaux cheveux. Et elle fronça les sourcils. – Pour celles-là, on ne donne que trois centimes le kilo.
«Mais dans les magasins, les nectarines coûtent deux euros cinquante le kilo. C’est du vol pur et simple !» pensa Tourov.
– Avant, les Fiore apportaient les pêches à Ravenne, dit Anna. Et ils les vendaient au marché.
Mais ces temps heureux, comme Denis le comprit, étaient révolus, avec les lires et les dirigeants nationaux. Désormais, les marchés étaient contrôlés par des monopoles qui n’avaient pas besoin des petits paysans et de leur marchandise.
Enzo semblait ne pas entendre les paroles de sa femme. Il était entièrement absorbé par le travail, qui apparemment ne le fatiguait pas du tout. Le paysan regardait les pêches avec de bons yeux bruns et souriait légèrement. Ses mains travaillaient vite et sûrement entre les branches, détachant les fruits. Il avait des mains très fortes, couvertes de poils noirs, aux doigts tenaces. Ces mains étaient le vrai trésor du paysan, car la vitesse de cueillette déterminait la quantité de fruits de qualité commerciale.
Pendant les courtes pauses, il fumait en silence, perdu dans ses pensées, mais sans inquiétude, plutôt rêveur, comme s’il était mentalement sur une île perdue dans l’océan. Probablement que seule une telle sérénité philosophique permettait de travailler à trois, sans embaucher d’ouvriers, sur douze hectares plantés de pêchers, de vignes et de poiriers.
Anna, elle, parlait sans arrêt. Par exemple du beau-père, grand travailleur, qui travaillait «toujours». Maintenant Boscòlo Fiore avait vieilli et ne sortait de la maison que pour se promener dans la cour, du hangar au potager et retour.
Août arriva, pas moins chaud, et il y avait encore énormément de pêches sur les arbres. Pour se distraire mentalement du travail, Denis s’imaginait en touriste agrotouristique. Las du chaos urbain, des climatiseurs de bureau et des gaz d’échappement, il aurait ressenti le besoin de produits naturels et de travail physique en pleine nature. Ces pensées l’amusaient un moment. Mais elles disparaissaient complètement quand il rentrait chez lui après le travail et sentait des douleurs dans le dos et les jambes.
Et puis il s’avéra qu’il devait aussi s’occuper de Boscòlo. À midi, Tourov cuisinait des raviolis pour lui et pour le vieux, les versait dans les assiettes avec le bouillon et râpait dessus du parmesan – rigoureusement le vrai, avec l’étiquette représentant le paysan et sa charrue tirée par deux bœufs.
Parfois, très tôt le matin, quand la Lune était encore dans le ciel, le grand et maigre Boscòlo faisait plusieurs tours dans la cour, et si on l’observait, on pouvait remarquer l’approche de l’infini et l’achèvement cosmique du chemin du vieil homme.
Les promenades matinales de Boscòlo devinrent de plus en plus courtes, et vers l’automne il ne les faisait plus qu’au bras de Tourov. Le vieux aimait s’occuper des tomates et traînait Denis au potager. Désormais Tourov devait aussi s’occuper de ce potager. Heureusement, le verrat Giovanolo, mangé en juillet, avait été le dernier habitant de la porcherie, sinon Tourov serait inévitablement devenu aussi porcher.
Le dicton selon lequel l’homme ne peut faire que ce que ses forces lui permettent perdit rapidement son sens. Tourov devenait peu à peu paysan, ouvrier-mécanicien et aide-soignant en même temps. Et avec les cinq cents euros qu’Enzo lui donnait chaque mois – une somme ridicule pour l’Italie – il n’y avait pas d’épargne possible. Certes, il ne payait pas de loyer, donc l’argent servait seulement à manger et s’habiller. Et à la campagne, on n’avait pas besoin de vêtements chers.
Si on mettait une grosse croix sur l’avenir, alors on n’avait besoin de rien : ni voiture, ni beaux habits, ni appartement en propre. Mais l’idée d’avoir quitté la Russie pour les Fiore et leurs pêches le mettait maintenant en rage.
Enzo avait promis à Tourov un bonus de mille cinq cents euros après la fin complète de la récolte. Mais maintenant le paysan disait qu’il ne le paierait que si Denis continuait à s’occuper de son père. Naturellement, une fois cet argent gagné, on pouvait chercher un autre travail. Ou rentrer à Lotochino et reprendre le boulot dans les réseaux électriques, qui ne risquaient pas de faire faillite avant cent ans.
Ces pensées calmaient un peu Denis, donnaient un certain sens à sa vie. Et en observant la famille Fiore, il commençait à les respecter pour leur immense travail. Et même à les plaindre.
Le samedi soir, Enzo faisait griller de la viande et des aubergines au barbecue. Il rôtissait porc, poulet et saucisses jusqu’à ce qu’ils croustillent, car il était convaincu que même la viande trop cuite au feu vif ne pouvait pas faire de mal à l’organisme. Surtout accompagnée de vin et d’«eau minérale» légèrement gazeuse. Pendant ces courtes soirées, Denis essayait à nouveau de s’imaginer en touriste ou même en noble russe du XIXe siècle venu «aux eaux». Mais cela ne marchait pas.
Le soir, le village – si on pouvait appeler ainsi l’ensemble de propriétés éparpillées dans les champs – était presque dans le noir, et à Tourov il semblait être à la périphérie du district de Lotochino. Alors il demandait à Enzo ou à Anna la permission de s’asseoir au salon devant l’ordinateur pour chatter sur Skype avec son frère.
Pendant qu’il était à l’ordinateur, autour de lui se déroulait la vie un peu étrange dans les détails de cette famille étrangère. Il entendait Anna, qui cuisinait dans la cuisine, marmonner sans cesse, de façon monotone et ininterrompue, comme si elle délirait presque. Une fois, en écoutant attentivement le murmure d’Anna, Tourov découvrit que les médecins lui avaient depuis longtemps donné leur verdict : elle n’aurait jamais d’enfants à elle. Pourquoi ? Anna pensait que c’était la faute du grand-père, qui après la guerre avait trop utilisé de produits chimiques dans le champ de maïs. Et pas seulement lui, mais tous les voisins. C’est pour ça qu’il y avait tant de couples sans enfants autour.
À certaines heures, selon le minuteur, sortait de la petite réserve un robot-aspirateur blanc en forme de disque nommé Filipino et commençait à tourner industriusement dans le grand salon, ramassant la poussière qui s’accumulait incroyablement vite sur les carreaux, formant des boules de poussière roulantes.
Après la vendange, les époux Fiore firent le compte des gains de toute la récolte. Pour la première fois en trois mois de vie à la ferme, Denis vit Enzo sombre, les yeux éteints. D’une conversation qu’il surprit par hasard, il comprit que la vente des fruits n’avait rapporté que six mille euros.
– Pourquoi tu ne parles pas à ton cousin ? reprochait Anna à son mari. Il a des relations, il fait des affaires à Ravenne.
– Je lui ai téléphoné, répondait Enzo d’une voix sourde.
– Et qu’est-ce qu’il a dit ?
– Il a dit : « Pourquoi est-ce que j’achèterais tes pêches ! Vends-moi plutôt toute la propriété. »
– C’est ce qu’a dit ton cousin ?
– Oui.
Puis vinrent les lamentations d’Anna et, pour la première fois aux lèvres d’Enzo, une bordée de jurons intraduisibles.
Enzo paya à l’ouvrier, pour le travail de cueillette, neuf cents euros, et promit de verser les six cents restants par petits montants avec le salaire mensuel.
L’automne arriva. En automne, ils taillèrent les branches dans le verger de pêchers. Les couronnes trop denses affaiblissent la production de fruits et les arbres vieillissent vite. C’est pourquoi le pêcher Enzo régulait la fructification et l’éclairage à l’intérieur de la couronne par une taille habile des branches et des pousses verticales.
L’arbre à grenades derrière la fenêtre de la chambre de Tourov perdit ses feuilles jaunies et ternes, et les fruits rouge-brun pendaient comme des décorations de Noël. Le matin, Denis aimait s’arrêter quelques minutes avec sa tasse de café à la fenêtre, admirant les lourdes grenades et les imaginant comme des planètes venues sur Terre d’une lointaine galaxie chaude.
Puis on cueillit les grenades, on les mit dans des caisses et on les rangea dans le hangar, et le monde dehors de la fenêtre de Tourov perdit de ses couleurs. Et après avoir cueilli les fruits de l’arbre à kakis, l’hiver arriva.
Un soir d’hiver, ayant laissé le grand-père devant la télévision, Denis alla dans la maison principale, chez Enzo. Dans le grand salon chauffé par la cheminée, on pouvait rester devant l’ordinateur jusqu’à tard. Enzo y était déjà en train de se reposer : après le dîner, il s’était allongé sur le canapé devant la cheminée, avait fumé une cigarette, feuilleté le journal « Ravenna », trouvé un article sur le football et… s’était assoupi comme d’habitude. Sur la petite table carrée en verre à côté du canapé se trouvaient un verre et une bouteille vide d’apéritif. À ce moment-là, le visage d’Enzo parut à Denis bouffi, ressemblant à celui de Mussolini, même si Fiore n’avait jamais été un sanglier compact comme le défunt Duce.
L’hiver, quand sous Noël les champs au matin étaient couverts d’un brouillard blanc et qu’ensuite il se mettait à pleuvoir, même dans le bruit de la pluie dans la cour Denis entendait la voix d’Anna : le même marmonnement sourd et méthodique ou un gémissement incompréhensible.
D’habitude vers onze heures Anna entrait au salon et réveillait son mari pour qu’il monte dormir au deuxième étage, dans la chambre conjugale.
Cette fois, ce fut l’aspirateur à disque qui tira Enzo de sa somnolence, sortant de son coin sous l’escalier.
– Filipino ne devrait pas nettoyer maintenant, s’inquiéta un peu Enzo, mais presque aussitôt il se calma : – Anna a déplacé le minuteur… C’est pour que je ne dorme pas ici. Les femmes, on les connaît…
Denis savait déjà pourquoi Enzo appelait l’aspirateur Filipino : pas très longtemps avant, en Italie, il y avait eu énormément de domestiques et d’employés de ménage philippins.
Regardant l’objet qui glissait sur les carreaux, Enzo, à moitié endormi, dit :
– À la télé, ils ont dit qu’hier les Philippins ont mangé un requin à grande bouche. Le plus rare au monde… Ils l’ont avalé tout entier. Donnez-leur l’occasion et ils avalent tout. Et notre gouvernement les défend toujours.
– On dit que les Philippins sont d’excellents marins, essaya de dire quelque chose Denis.
– Pour les marins, je ne sais pas. Mais tu aurais dû voir comme notre avocat a été poli avec cet employé de ménage philippin ! Il le justifiait même pour son travail médiocre…
Enzo était presque en train de se rendormir, mais il sursauta et ouvrit les yeux. Sans cligner, il fixa comment Filipino continuait de ramasser la poussière autour des pieds de Denis.
– Qu’est-ce qu’on peut y faire, dit soudain Enzo. À qui tout cela reviendra-t-il ? Quand je serai vieux comme mon père, qui travaillera dans le verger ? Un Albanais quelconque ?… Ou un humble Philippin ? Un homme de famille, bon catholique, avec des pantalons serrés, la chemise dehors et un chapeau. Avec un nom espagnol pompeux : Carlos… Ou Balthazar, qu’est-ce que tu en penses ?
– Peut-être José ? suggéra Denis et il comprit aussitôt qu’il avait mal fait : le visage d’Enzo se tordit en une grimace de douleur.
– Et on dira : ici vivaient autrefois Enzo et sa femme, maintenant c’est José. – Le paysan, il sembla à Denis, regardait l’aspirateur avec haine. – Et puis on oubliera complètement Enzo, et il ne restera que José. Pas très riche, mais qui aime beaucoup les enfants…
Du deuxième étage commença à descendre Anna. Elle marmonnait quelque chose sur son mari endormi, sur sa passion pour les engrais… Sur les Russes bizarres qui n’ont rien de mieux à faire que de se ruiner les yeux dans le monde virtuel. Elle réveilla son mari et l’accompagna à l’étage.
Déjà passé minuit, Anna redescendit au salon, en pyjama. Elle n’avait pas honte de Denis. D’ailleurs au salon la grande lumière était éteinte, et la pièce était à peine éclairée par la cheminée qui s’éteignait.
– Denis, tu disais que tu as fait électricien, dit Anna et elle passa dans la petite chambre d’amis. Elle effleura Filipino du pied, et celui-ci repartit soudain.
– Oui, je travaillais, répondit Denis.
– Viens voir la prise, se fit entendre la voix étouffée d’Anna depuis la chambre d’amis.
– Maintenant ?!
Avec elle, de toute façon, il était inutile de discuter : elle pouvait avoir une crise d’hystérie. Au fond, elle l’appelait seulement pour regarder, la réparation pouvait attendre le lendemain. Et Denis la suivit. Et Filipino se jeta entre ses pieds, comme s’il ne voulait pas le laisser passer.
Dans la petite pièce, la lampe au-dessus du grand lit était allumée. Anna était debout près du lit. Elle avait déjà enlevé la partie supérieure du pyjama. Puis elle enleva le reste. Elle s’assit sur le lit, s’allongea sur le dos, offrant à Denis la possibilité de la regarder tout entière.
La peau d’Anna était blanche. Hanches larges, sur les grands hémisphères de la poitrine des tétons minuscules, qui n’avaient jamais connu la bouche avide d’un enfant. Anna avait une taille plutôt fine, chose à laquelle Denis n’avait jamais prêté attention. Visiblement, tous ces chemisiers, blouses, robes amples, elle les choisissait justement pour cacher la poitrine abondante. Et elle avait caché la chose principale – avec celle-là il n’y avait pas de concurrence dans son corps – la taille, qui ne peut appartenir qu’à une femme capable d’accoucher d’enfants sains.
– Eh bien, qu’est-ce que tu fais planté là ? Viens ici, l’appela Anna.
Filipino fila entre les jambes de Denis dans la pièce et se mit au travail : il entra sous le lit, puis ressortit de l’autre côté, tournant et contrôlant le sol centimètre par centimètre. Son zèle était si déplacé dans la petite pièce où sur le lit gisait une femme nue.
Anna, relevant la tête, s’appuya sur le coude et elle aussi regarda l’aspirateur – avec un grand soupçon, les yeux un peu plissés… Dans son corps, Denis remarqua une certaine irrégularité. Et il comprit qu’il n’avait absolument pas envie de posséder cette femme, avec ces hanches lourdes à la Rubens, si peu adaptées à la taille. Une sorte de manuel raté de dessin hentai.
Anna, se reprenant, tourna son visage pâle vers Denis, le regarda avec des yeux grands ouverts, presque fous, et ordonna avec rage :
– Allez !
Filipino, passant par là, sembla trébucher : il s’arrêta et fit un clin d’œil à Denis avec son petit œil vert.
Denis enleva sa chemise, puis son jean. Il comprenait que s’il n’obéissait pas, le lendemain Anna dirait des horreurs sur lui – jusqu’à ce qu’Enzo le mette à la porte. Même l’équilibré Enzo ne supporterait pas une autre de ses crises de neurasthénie, de maux de tête et d’irritabilité. Passa faiblement la pensée : « Enzo m’a donné toit et travail… », mais les jambes le portèrent d’elles-mêmes vers le lit.
Le corps féminin, parfumé de chocolat, était tendu, il avait plus d’énergie que de biologie et d’anatomie, et Anna savait comment l’utiliser, comment contrôler avec cette énergie Enzo et Denis, même Filipino. Comment dominer ce lit, cette chambre, cette maison abandonnée dans la dure et aride plaine du Pô, qui chaque année s’enfonçait un peu plus dans l’attente de la marée haute marine. Le cerveau masculin était impuissant devant cette énergie…
Le lendemain matin, Enzo alla faire le journalier chez un paysan riche. Au début il y allait seul, puis il commença à emmener aussi Denis. Ils travaillaient huit euros de l’heure comme chargeurs et conducteurs de tracteur. Ils se levaient à cinq heures, buvaient le café, prenaient la nourriture dans des boîtes en plastique Tupperware et partaient avec la voiture d’Enzo pour cinquante kilomètres de Faenza. Ils rentraient chez eux seulement à huit heures du soir. Malgré le fait qu’Enzo gardait tout le gain pour lui, Tourov éprouvait des remords de conscience. Il se sentait traître, Judas, et rêvait de partir au plus vite de ces lieux.
Pendant ce temps, Anna s’occupait d’élever des lapins. Elle avait réussi à s’entendre avec le propriétaire d’une trattoria où les plats de lapin étaient très demandés et chers.
À Noël, Enzo et Anna laissèrent la propriété à Denis et partirent chez des parents à Vérone. Deux jours, Tourov les passa seul, si on ne compte pas le presque gâteux vieux Boscòlo, qu’il fallait nourrir à la cuillère, laver, habiller et promener.
Quand Enzo et Anna revinrent, Denis, épuisé par la faim de contacts humains, demanda la permission d’aller se promener à Bologne ou Mantoue.
– Aucun problème, même demain, dit Enzo, dont le visage montrait clairement à quel point il était heureux d’être revenu des parents dans sa propriété. Ce soir-là, les époux Fiore laissèrent Denis seul au rez-de-chaussée devant l’ordinateur, et montèrent dans leur chambre. Et presque aussitôt arrivèrent à Tourov des soupirs passionnés et le grincement étouffé du lit. Enzo ne s’était même pas soucié de bien fermer la porte de la chambre.
« Pour eux je suis un meuble ! pensa Tourov en éteignant l’ordinateur. Ou un robot sans âme », – Denis se leva et donna un coup de pied rageur à Filipino qui passait par là. Il se hâta de sortir vers l’ancienne maison.
Le lendemain matin, le paysan emmena son ouvrier à Faenza. Enzo était d’excellente humeur. Il alluma la radio, écoutait des chansons anglaises et essayait même de chanter, bien qu’il ait eu de gros problèmes avec l’anglais.
– À Mantoue, trouve-toi une fille, conseilla-t-il soudain à Denis. Il y en a plein là-bas.
– Sûr.
Pendant tout le trajet, Tourov n’attendait qu’un moment: que Enzo disparaisse de sa vue avec sa jeep.
Tourov entreprit un voyage à Bologne, où il était déjà allé auparavant, puis à Mantoue.
À Mantoue, il faisait froid et humide, malgré les neuf degrés au-dessus de zéro. Il tombait une petite pluie fine et désagréable, et les rares passants, couverts des capuches de leurs vestes ou d’énormes parapluies, se hâtaient vers les galeries typiques de l’architecture italienne, disparaissant dans les boutiques et les pâtisseries, où par un temps pareil il était agréable de boire un chocolat chaud. Les parasols des cafés-chantants étaient fermés, et les chaises en plastique étaient empilées les unes sur les autres – comme des colonnes vertes courbées.
Arrivé dans la partie historique de la ville, Denis vit un Afro-Italien qui vendait à un étal divers objets tous au même prix – cinq euros. Denis acheta un grand parapluie vert et se dirigea vers le musée du Palazzo Ducale. Mais dans les galeries et les couloirs du Palazzo Ducale, il faisait froid comme dans une cave. Après avoir visité deux ou trois des cinq cents pièces du Palais, Denis pensa : « À l’entrée, ils devraient distribuer des bonnets de fourrure avec des oreillettes ! »
Après le palais, emprisonné par le froid médiéval des cachots, les rues de Mantoue parurent à Denis chaudes et familières, et sans s’en rendre compte il arriva presque jusqu’à la rive du fleuve, se retrouvant dans un parc désert, au fond duquel se dressait un monument. Un homme de bronze, majestueux comme un empereur, vêtu d’une toge, le bras plié au coude, tendait la paume sous les cieux pleurants. Denis n’arriva pas jusqu’au monument, car la pluie s’intensifia et sur les chemins rougeâtres, presque de gravier, commencèrent à se former des flaques.
Pour se distraire un peu, il acheta dans une tabaccheria un billet de la loterie Miliardario. Sans sortir dans la rue, il sortit de son portefeuille une pièce de cinquante centimes avec l’image de la zone offshore de Saint-Marin. Il portait toujours cette pièce dans son portefeuille, espérant qu’un jour elle lui apporterait de la chance.
« Mieux valait que j’aille à Parme, pensa Denis en grattant avec la pièce la pellicule du billet de loterie. Là-bas, à la Galerie Nationale, paraît-il, il y a une exposition de tableaux fantastique. » Ici il sentit son cœur battre irrégulièrement. Tous les dix chiffres indiquaient un prix de 10 euros. Il regarda le billet encore et encore, et se convainquit : il avait gagné cent euros. C’était une chance !
Maintenant il avait de quoi s’occuper : encaisser le billet et fêter la victoire dans un café ou un restaurant. C’est pourquoi, quand le vendeur de la tabaccheria lui demanda : « Voulez-vous d’autres billets ? », Denis répondit avec assurance : « Soldi ».
Pendant un moment il marcha, cherchant un endroit pour un agréable passe-temps. Et voilà, dans la partie historique de la ville lui plut un café littéraire – un café littéraire au nom « Venezia ». Il passa par le bar dans un large arc, derrière lequel se trouvait une salle très accueillante, aux murs blancs sur lesquels étaient accrochées des photographies en noir et blanc dans des cadres carrés, et des armoires étroites avec une collection de théières, de tasses et d’assiettes cadeaux.
Denis enleva sa veste et la suspendit au dossier large, semblable à une conque marine, d’une chaise en osier, s’assit et regarda autour de lui. La moitié des tables était vide, et dans un coin, sous un samovar russe qui trônait sur une étagère fixée au mur, un groupe de vieilles Italiennes discutait animément de quelque chose. Non, elles commentaient simplement à leur manière habituelle les réductions des soldes. Sales, sconti, saldi, shopping – de quoi d’autre pouvaient parler les femmes dans les jours avant le Nouvel An !
Elles ne ressemblaient pas à des poétesses, mais un monsieur distingué aux cheveux gris, qui se tenait debout près de l’armoire des livres et cherchait quelque chose avec application dans l’un des volumes illustrés en couleurs, pouvait être un écrivain ou un critique d’art.
On entendit de la musique, une valse. L’homme sortit de sa sacoche à bandoulière un Siemens, le porta à l’oreille et dit en russe :
– Tu m’as déjà fait les vœux pour le Nouvel An ! Fêtard, appelle-moi dans une semaine. Je suis à l’étranger, – et il remit le téléphone dans sa poche.
En observant le compatriote, Denis comprit qu’il avait choisi la place la plus confortable dans le café, dans le petit coin près de l’armoire de littérature. Près de sa table, à côté du portemanteau qui ressemblait à une paire de skis attachés avec du scotch, sur l’une des chaises libres se trouvaient un manteau court en drap et une écharpe blanche.
Quand la serveuse apporta au monsieur le menu et la carte des vins, et s’en alla, Denis s’approcha de l’armoire des livres et demanda doucement en russe :
– Excusez-moi, savez-vous à qui est dédié le monument dans le parc ?
– Dans le parc ? répéta un peu confus l’homme et regarda celui qui l’avait interpellé. Denis remarqua aussitôt que la monture allemande en titane des lunettes du monsieur coûtait pas moins de cent euros.
Denis leva la main droite, imitant la sculpture. L’homme répondit avec un sourire :
– À Virgile. Ils l’appellent le Cygne de Mantoue.
– Vous êtes un écrivain ?
– Non. Mais, comme Onéguine chez Pouchkine, autrefois je me souvenais « non sans péché de deux vers de l’Énéide »… Excusez la curiosité : vous êtes aussi un touriste ?
– Je travaille ici. Permettez-moi de me présenter. Denis. Ne voulez-vous pas vous asseoir à ma table ?
– J’ai déjà commandé. Donc mieux vous chez moi. Ici c’est très accueillant, dans le petit coin. Et expliquez-moi ce qu’est le mascarpone. Parce que j’ai commandé je ne sais quoi.
Quand Denis s’assit à la table du Russe, celui-ci se présenta :
– Gourski, Evgueni Borissovitch. Je m’occupe d’édition. Je suis venu voir si je m’installais ici pour de bon. Je voudrais une vieillesse tranquille dans un environnement accueillant. Comme disait Aristophane : « Ubi bene ibi patria » – où l’on est bien, là est la patrie. Ici, admettons-le, c’est confortable.
– Et en Russie la vie n’est pas confortable ?
– Ça dépend pour qui…
La serveuse apporta le vin blanc et le risotto « con puntel » – riz avec de la viande frite. Et le mascarpone commandé auparavant par Gourski. Les hommes trinquèrent à leur connaissance et se mirent à manger le risotto.
– Le mascarpone est un fromage. Ça ressemble à une crème, on peut l’étaler sur du pain, expliqua Denis. On le fait avec de la crème de bufflonne.
Gourski goûta le mascarpone, claqua des lèvres et avec la mimique montra que le goût du produit était excellent.
– N’importe quel Roméo ici grossirait sûrement et oublierait Juliette.
– Avec ça on fait d’excellents desserts, dit Denis, faisant allusion poliment que le mascarpone se mangeait à la fin du repas. – Vous dites que c’est confortable ici. Ça dépend du point de vue. Moi ici j’ai vécu un couple d’années… En Russie c’est mieux.
– Sérieusement ? demanda Gourski, dévorant le risotto avec appétit. – Permettez-moi de ne pas vous croire.
– Vous pouvez ne pas croire. Les premières impressions s’atténuent vite. Et les gens s’abrutissent. Au début on s’extasie devant les arômes locaux, comme une demoiselle. Ah, quelle merveille le pain italien ! Parfumé, de formes différentes, il y en a même en forme d’étoile de mer. Et que dire de la salade avec figues et jambon !.. À moi ça m’a bien réussi : je me suis installé chez un paysan, Enzo. On travaillait de l’aube au crépuscule. Et le soir – pas de confort : dîner et au lit. Tandis qu’en Russie le confort signifie encore un travail qui plaît, même si l’argent est peu. Les vacances – avec les chameaux en Égypte ou avec les braconniers sur l’Achtouba.
– Voilà comment vous entendez le confort, – Gourski essaya de sourire.
– Et alors ? Une veste décente, qui ne se salit pas, et surtout économique, comme en Italie ! Les vieux ont la retraite… eh bien, au moins une. Le vendredi à la maison en vitesse. La télé – comme un thriller en direct. Sur le canapé – le chat ou, en cage, le cochon d’Inde. La datcha – pour y travailler et pas seulement. Week-end, chachlik au bord de la rivière, amis.
– Il y a longtemps que vous n’êtes pas retourné en Russie, nota Gourski. Il repoussa l’assiette avec le risotto restant. – À Moscou, où que tu ailles, qui que tu demandes – tous ont des problèmes. Crise. Comme on dit chez nous : surabondance de personnel dans des conditions de salaires très bas. Et Enzo, probablement, prospère.
– Il a fait faillite. C’est pour ça qu’il nettoie la merde dans une ferme étrangère, à huit euros de l’heure. Avec les Albanais de passage. – Des ses voyages à la journée avec Enzo, Tourov ne parla pas.
– Voyez, jeune homme. Tout ce que nous voyons aujourd’hui est le résultat de la soi-disant économie globale. Et la Russie en est aussi coupable.
– Et la pauvre Russie, qu’est-ce qu’elle vient faire là ?
– Combien de gens sont arrivés ici de tous les pays et villages. Compte seulement les femmes ! J’ai entendu que seulement dans cette province il y a sept mille Ukrainiennes.
– Les femmes ne sont pas des pêches, nota Tourov.
– Juste. Mais parmi elles il y en a d’énergiques à la pelle. Et puis elles ont fait venir ici leurs hommes – du travail pour tous ! D’anciens présidents de kolkhozes ont acheté des pêches en Chine, les vendent en Italie, et emportent les capitaux en Russie. Voilà pour vous « Wimm-Bill-Dann », et Parmalat. Et le port de Rimini, que Vitia Vekselberg a acheté. La production du petit paysan Enzo peut-elle résister à une telle concurrence ? La politique, mon ami, est mêlée, on n’y échappe pas…
Pendant un moment Gourski se tut, attendant que l’interlocuteur dise quelque chose. Puis il ajouta :
– Si ici pour vous c’est insupportable, allez plutôt en Amérique. Là-bas beaucoup des nôtres travaillent dans le commerce.
Denis, qui sur Internet bavardait avec des émigrés de divers pays, sourit et commença à raconter :
– Une fille aux États-Unis travaillait comme caissière, dans un supermarché. Là-bas c’est normal le soir de mettre l’argent dans une boîte couverte de plastique adhésif, et personne à la fin de la journée ne compte les dollars. Et le matin tôt, avant le tour, arrive un autre caissier, contrôle et écrit un billet sur les manques. Pour ma connaissance ça a été un cauchemar. Ça a duré seulement six mois, puis elle a démissionné. Et elle s’est installée dans un magasin de vêtements. Là, en apparence, le système est excellent. Le soir tard, après la fermeture, on imprime un rapport de toutes les transactions, cartes de crédit, tickets et liquide. On compte, on entre le nombre de centimes, dollars, billets de dix, vingt et ainsi de suite, et puis on imprime un nouveau rapport qui sert à la comparaison des bilans. En présence du manager et, naturellement, avec les rapports produits par l’ordinateur. Ça semble un rêve ! Mais pas tout à fait. Comme il s’est avéré, la direction pratiquait la rotation des caissières, c’est-à-dire qu’on en changeait quatre ou cinq par jour derrière la caisse. Et toi tu trembles comme une feuille, comptant sur l’honnêteté des collègues. Bref, un autre abîme.
Denis depuis longtemps ne parlait avec personne de ces sujets, donc, voyant en Gourski un auditeur attentif, il parlait et parlait, et ne pouvait s’arrêter :
– Et les congés des vendeurs américains sont peu. Il faut travailler cinq ans dans une compagnie pour gagner trois semaines de vacances, sinon ce n’est que deux. Pendant les vacances on paie seulement pour les cinq jours. Les maladies d’habitude – sept jours par an. Si on ne les utilise pas, elles disparaissent. Elles sont payées comme les vacances : un peu moins que le salaire d’une semaine pleine. L’assurance maladie est chère, mais elle couvre quatre-vingt-dix pour cent des coûts médicaux. Sans assurance – pire que ça n’existe pas : une couronne sans assurance – mille dollars jetés !
– À Moscou même avec l’assurance tu donnes mille pour une couronne, s’anima Gourski. – Mais… nous sommes dans un café littéraire, et nous parlons d’argent. Ce n’est pas bien. Dommage que la muse ne soit pas descendue ici. J’aurais composé un conte.
– Sur quoi ?
– Sur la Russie contemporaine, naturellement. Et le conte commencerait ainsi : « Il était une fois dans la forêt obscure Friske, Deripaska et Pisanka*… ». (*animatrice télé, éditrice, actrice connues à l’époque)
Les deux éclatèrent de rire. Puis ils levèrent les verres et les firent tinter, attirant l’attention des autres clients. En buvant le vin du verre, Denis demanda :
– Ça ne serait pas trop glamour ?
– Non, qu’est-ce que vous dites ! Le glamour est l’idée que le vulgaire se fait de la vie luxueuse… Excusez la question indiscrète : vous, Denis, allez à l’église ?
– Bien sûr, j’y vais… Rarement. Récemment à la communauté orthodoxe on a donné un bâtiment d’une église catholique.
– Peut-être que c’est bien que ce soit rarement.
– Pourquoi ?
Gourski ne répondit pas tout de suite.
– Je ne peux pas répondre brièvement à cette question. Dans ce cas, la brièveté est sœur de la tarentule ! – Gourski rit de son calembour. – Parlons d’autre chose pour l’instant. Vous avez besoin d’argent, n’est-ce pas ? Et moi j’ai besoin d’un assistant éveillé qui sache l’italien. Je vous propose une sorte de partenariat. Vous m’aiderez à acheter une petite maison économique au village. Arrangez-vous avec Enzo pour trois jours de congé. Je prendrai une voiture de location. Disons, deux cents euros ça vous va ?
– Quatre cents.
– Arrêtons-nous à trois cents.
Denis réfléchit peu :
– Plus la nourriture, précisa-t-il. – Et tenez compte : à aucun émigré russe ne plaît la cuisine italienne. Avec Enzo et son barbecue ça m’a bien réussi.
Quand Denis revint au village et demanda à Fiore de le laisser pour trois jours, Enzo réagit à la demande de son ouvrier avec mécontentement et une méfiance inattendue. Il essaya de découvrir si l’ouvrier ne s’était pas amoureux de quelque Ukrainienne. Tourov essaya de raconter sur Gourski, mais il vit qu’Enzo ne croyait pas un seul mot.
– Nous avons beaucoup de travail, dit Enzo, les sourcils froncés, et il refusa catégoriquement la demande de Denis.
Apprenant par la conversation téléphonique que Denis ne pouvait rien lui aider, Gourski se désola, mais aussitôt se calma et dit :
– Vous, Denis, devriez quand même prendre une formation. Peu importe où, en Russie ou en Italie, mais étudiez absolument. Mon conseil – inscrivez-vous à l’université. Essayez votre chance ! Comme on dit, si tu ne mords pas la noix, ne te plains pas de la pauvreté.
Le lendemain matin, quand Tourov après la douche revint dans sa chambre enveloppé dans la serviette, il vit Anna. En lingerie – elle avait occupé son lit. Et elle était assise dans une pose très libre – une jambe pliée sous l’autre, si bien que les genoux étaient bien écartés. Voyant Denis, Anna se leva, s’approcha de lui et l’enlaça. Son corps chaud, la peau douce – tout sentait le raisin. Ces odeurs changeantes de elle rendaient littéralement fou Tourov. Il demanda :
– C’est quel parfum ?
– Ça te plaît ?
– Beaucoup.
– Crèmes de Saint-Marin.
Avec avidité il posséda Anna, sans même penser que le vieux dans la chambre voisine s’était sûrement réveillé.
…Quand il se leva du lit et commença à s’habiller en hâte, il découvrit sur la table le risotto, les petits pains et la viande préparée la veille au barbecue.
– Ça pour vous et Boscòlo à midi, expliqua Anna, elle leva les bras et s’étira sur le lit comme une chatte repue. Puis, comme en somnolence, elle murmura avec un sourire : – Même les causes nobles ont un prix.
– Nobles ? précisa Tourov, un peu perplexe.
– Ça m’est venu comme ça…, elle se leva et, sans hâte, commença à s’habiller.
– Intéressant, quoi ?
– Comme je voulais prendre un enfant de l’orphelinat. D’abord de l’italien, puis je me suis mise en contact par Internet avec l’Ukraine. Mais il s’est avéré que même les causes nobles ont un prix… Imagine, Enzo a su le montant et dit : « Tu t’es trompée, tu as appelé un bijoutier. Un nouveau-né ne peut pas être fait d’or à 750 carats », – à Denis il sembla que les derniers mots elle les avait dits avec une rage sifflante. – Ou peut-être que ce n’est pas la faute du grand-père-chimiste. Peut-être que c’est la faute d’Enzo. Toi qu’est-ce que tu en penses ?…
À ce moment-là on entendit une forte toux de vieux, et la porte s’ouvrit. Dans la chambre, droit sur la demi-nue Anna, regardait Boscòlo.
Tourov prit les cigarettes sur la table de nuit et, se tournant vers la fenêtre, alluma, attendant qu’Anna sorte de la chambre et que la terrible situation se résolve d’elle-même.
De la fenêtre il vit Anna traverser en hâte la cour et disparaître dans la nouvelle maison. Derrière elle, s’appuyant lourdement sur la canne, traîna le vieux Boscòlo. De quoi ils parlèrent ensuite dans la maison, c’était facile à deviner.
Toute la journée Denis attendit qu’Enzo vienne chez lui avec le fusil, ou l’appelle pour le règlement de comptes. Mais Enzo l’appela à travailler dans le jardin. Et de nouveau ils taillèrent les branches. À deux. En silence. Denis travaillait exprès de manière que le paysan soit toujours dans son champ de vision. « Il manquait plus qu’il me plante les cisailles dans le foie », pensait Tourov.
Une semaine passa, une autre. Personne ne dit à Denis un mot mauvais. Anna ne vint plus dans sa chambre. Vers la mi-février Boscòlo tomba tout à fait malade, il ne se levait presque plus du lit et pour aller aux toilettes il marchait le long du mur, auquel Denis avait vissé exprès des poignées.
Un soir Tourov, après avoir nourri le vieux à la cuillère, sortit dans la cour et vit Enzo, qui se tenait devant la maison avec une bouteille de bière et regardait les étoiles, surgies au-dessus du verger de pêchers plongé dans l’obscurité. C’était inhabituel pour un Italien – boire de la bière en hiver en plein air.
Entendant les pas de l’ouvrier, Enzo, sans tourner la tête, demanda :
– As-tu déjà vu les pêchers en fleur ?
– Non.
Denis se mit à côté du paysan et regarda lui aussi le ciel. Basse sur l’horizon brillait une étoile bleuâtre.
Enzo but une gorgée de bière et, toujours sans regarder l’interlocuteur, dit :
– Dommage. Il est temps que tu partes.
Tourov regarda un moment l’étoile, qui à Denis parut familière… Oui oui, il en avait vu une semblable enfant, dans la natale Lotochino. Une fois jusqu’à minuit il avait regardé les étoiles de la fenêtre, parce que ce jour-là on fêtait l’anniversaire de Denis, et le père lui avait offert un petit télescope. Le père lui avait aussi dit : « Si tu voyages, ça te servira pour ne pas perdre de vue la maison. »
– Adieu, Enzo de Faenza. – Denis sentit de nouveau la colère.
– Pas maintenant, la voix du paysan trembla, ou seulement parut à Denis ? – Demain matin tu auras le solde. Complet, sans retenues. – Dans la voix d’Enzo il n’y avait pas une once d’émotion.
Denis regarda par la fenêtre illuminée du salon et vit Anna, vêtue d’une robe très ample. La maîtresse se tenait devant le miroir et pour quelque raison avançait et caressait son ventre. À ses pieds l’aspirateur traçait des cercles de sorcière.
Denis Tourov fut saisi d’un frisson, puis d’une chaleur. Le fort désir de saisir le paysan à la gorge réussit à le réprimer avec un grand effort.
– Nous sommes tous ici… philippins ! murmura-t-il, s’adressant à l’étoile bleuâtre.
Puis, sur des jambes raidies, il se dirigea vers l’ancienne maison. Il fallait se préparer au départ.
Quand il n’y a pas de pluie et le brouillard épais habituel de début janvier, les aubes de Nouvel An de l’Italie du Nord sont fraîches et transparentes. Dans l’air humide, lourd pour un Russe, pend une lune presque pleine et claire. Les basses montagnes, qui le soir s’insèrent doucement dans l’horizon jaunâtre, au matin se détachent nettement sur un fond rose tendre du ciel. Dans les propriétés éparpillées entre les champs et les vergers de la province, dans cette partie qu’on appelle Romagne, règne un silence parfait.
À huit heures du matin soudain sonnent les cloches sur la place du village le plus proche, et ce son, délicat, comme si les horloges craignaient non seulement de réveiller les gens qui se fâcheraient et porteraient plainte au commissariat, mais aussi d’offenser la nature. Mais les paysans, qui au début de l’année ont le moins de travail, se lèvent quand même tôt par habitude.
C’est l’hiver, mais la neige ne se voit nulle part. Si par une journée ensoleillée on regarde les magnolias verts, on observe leurs feuilles charnues et brillantes, on peut penser – c’est le printemps, ou peut-être l’été bat son plein.
En des jours comme ceux-ci Enzo Fiore s’assied au salon sur le canapé, face à la cheminée, lit « Ravenna » ou, s’assoupissant, observe les pirouettes de Filipino, dont la coque ronde semble flotter au-dessus du sol, heurtant les objets et tournant autour de son axe.
L’un de ces jours dans la propriété arriva une tourterelle grise semblable à un pigeon. Elle se posa sur le toit de la nouvelle maison et commença à roucouler fort, comme pour appeler les habitants de la zone à communiquer une nouvelle importante. Et dans sa voix Enzo entendit on ne sait pourquoi les intonations d’Anna.
La maman disait que cet oiseau apporte la chaleur de Calabre. Bien sûr, la maman se trompait. D’après les observations d’Enzo, la tourterelle apporte des visiteurs dans la propriété. Voilà, avant l’arrivée de l’ouvrier russe était aussi venue cette tourterelle, avec les taches noires et gris-bleu en « miroirs » sur le cou. Elle était sur le magnolia et roucoulait bas, sourd… « Sans aucun doute, la tourterelle amène des visiteurs à la ferme, – pensait Enzo. – Et une nouvelle vie. Oui oui, une nouvelle vie. C’est certain. »